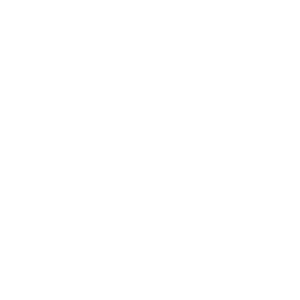En introduction, Pr Ndeye Massata NDIAYE, Enseignante-chercheure et Directrice de l’Ecole doctorale pluridisciplinaire de l’UN-CHK, a souligné l’importance de la science ouverte pour la recherche, l’accès aux données et le développement durable au Sénégal.
Dans la foulée, Dr Moussa SAMBA a présenté l’expérience de l’UCAD, affirmant que malgré l’absence initiale de communication officielle, des pratiques relevant de la science ouverte existaient déjà à travers des initiatives personnelles. Selon lui, c’est à partir de 2020 qu’une démarche institutionnelle a été lancée avec la création d’un portail pour les publications académiques. Ce processus, marqué par des lenteurs dues à des incompréhensions sur la gratuité et le financement, a véritablement pris forme en 2023, avec une dizaine de sites en accès libre désormais opérationnels, a-t-il ajouté.
A sa suite, Dr Cécile COULIBALY, représentante de l’UVCI, a centré son intervention sur la mise en place de la Bibliothèque virtuelle de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, en insistant particulièrement sur la question des identifiants persistants. Ces derniers visent à améliorer la visibilité, l’accessibilité et la réutilisation des publications scientifiques. Dr Coulibaly a souligné les difficultés rencontrées par les chercheurs pour retrouver leurs propres travaux en ligne, ce qui traduit un déficit de maîtrise de l’information scientifique. Elle a, dès lors, mis en avant la nécessité de renforcer la culture numérique informationnelle, tant chez les chercheurs que chez les professionnels de l’information. Elle finit son intervention par rappeler que dans un contexte marqué par l’insuffisance des politiques documentaires, la science ouverte représente une opportunité stratégique pour développer des politiques d’accès et de valorisation des résultats de la recherche, qu’il s’agisse de publications ou de données.
Les expériences des partenaires (IRD et UNESCO)
Pour M. Hugo CATHERINE, la science ouverte constitue un levier politique pour déployer deux priorités de l’institut : la science de la durabilité et le dialogue sciences-sociétés. L’IRD a ainsi élaboré une feuille de route ayant abouti à un plan d’action de 70 mesures. Ce cadre a permis de mettre en place une coopération panafricaine multipartenaire en soutien aux recommandations de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Trois volets structurent cette action : le renforcement de capacités, avec un diplôme universitaire en gestion des données de la recherche, les dispositifs de publication, avec le projet ALMASI (Aligning and Mutualizing Nonprofit Open Access Publishing Services Internationally) visant à créer un écosystème scientifique non lucratif, durable et de qualité entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique latine et la sensibilisation, à travers l’organisation biennale de colloques scientifiques internationaux, comme à Dakar (2019), Cotonou (2022) et Le Cap (2024).
Par ailleurs, M. Hugo est revenu sur les recommandations issues de la conférence du Cap sur la science ouverte en Afrique. La première appelle au renforcement des capacités locales et à une répartition équitable des bénéfices de la recherche, pour réduire les inégalités, valoriser les savoirs locaux et orienter la recherche vers les enjeux nationaux. La deuxième porte sur la création d’un réseau structuré des acteurs de la science ouverte en Afrique, pour favoriser l’échange de bonnes pratiques, le partage d’outils et la réflexion sur les aspects politiques, organisationnels, numériques et de formation. La troisième insiste sur le multilinguisme et l’inclusion des communautés locales dans la production et la diffusion scientifique, afin d’élargir l’impact de la recherche africaine. Enfin, la quatrième préconise une évaluation de la recherche plus inclusive, valorisant toutes les formes de production scientifique et leur impact sociétal.
A son tour, Mme Kornelia TZINOVA de l’UNESCO a expliqué tout d’abord les quatre piliers de la science ouverte, fondés sur les principes d’inclusion, d’équité, de justice et de partage, visant à renforcer la rigueur, la responsabilité et la reproductibilité de la recherche. Elle a souligné les domaines d’action de la recommandation de l’UNESCO, notamment, la sensibilisation, un environnement politique favorable, l’investissement dans les infrastructures, la promotion de la culture de la science ouverte, les approches inclusives et la coopération internationale et régionale.
Les échanges entre intervenants et participants ont enrichi le débat par la diversité des perspectives. Cette édition a permis de discuter des enjeux de la science ouverte au Sénégal et de partager les recommandations issues des conférences récentes sur le sujet.
Suivez l’intégralité de la session via le lien suivant : RVR – avril 2025
Dr Mohamadou Ibnou Arabe KONTEYE
Pôle d’Innovation et d’Expertise pour le Développement (PIED)